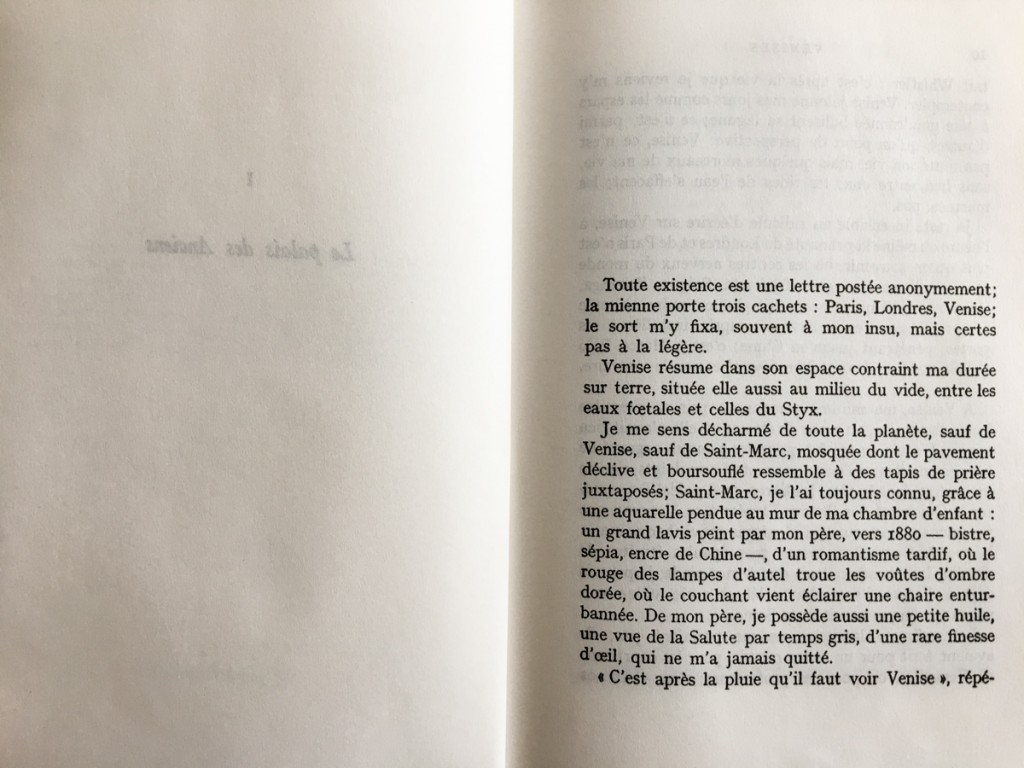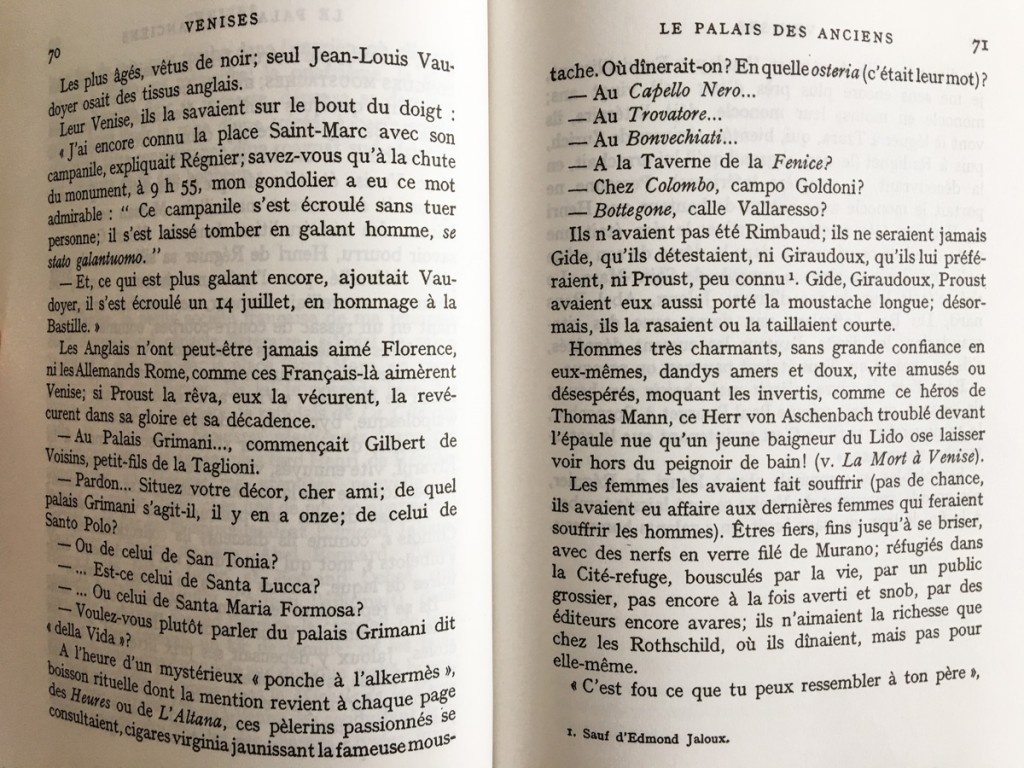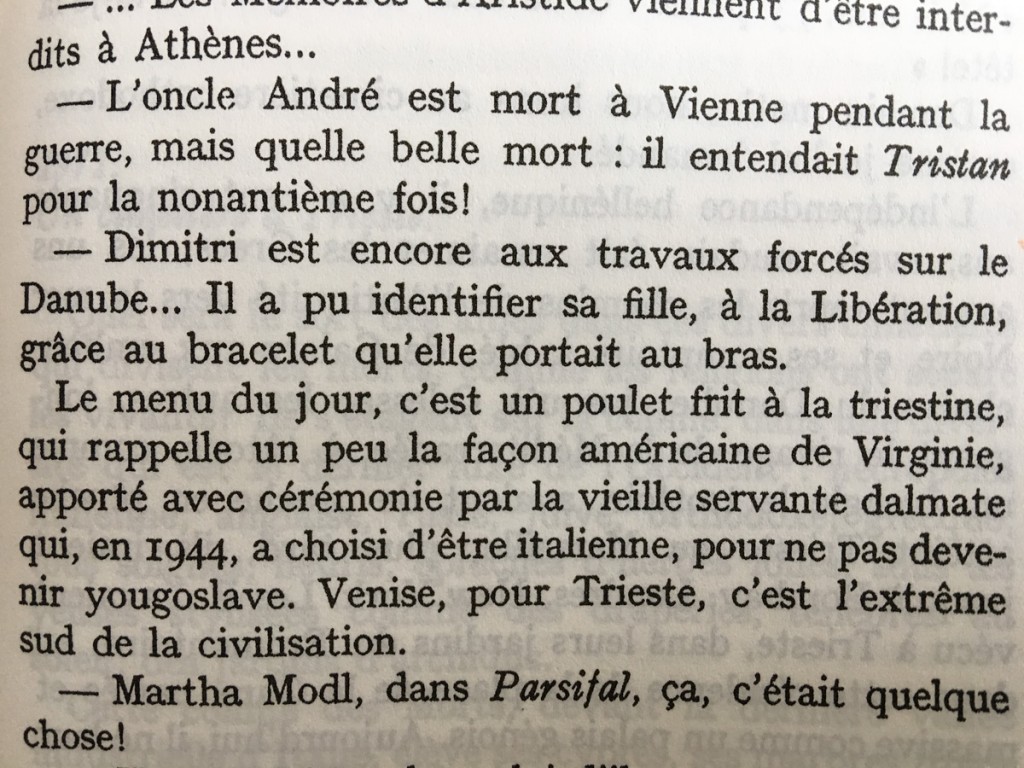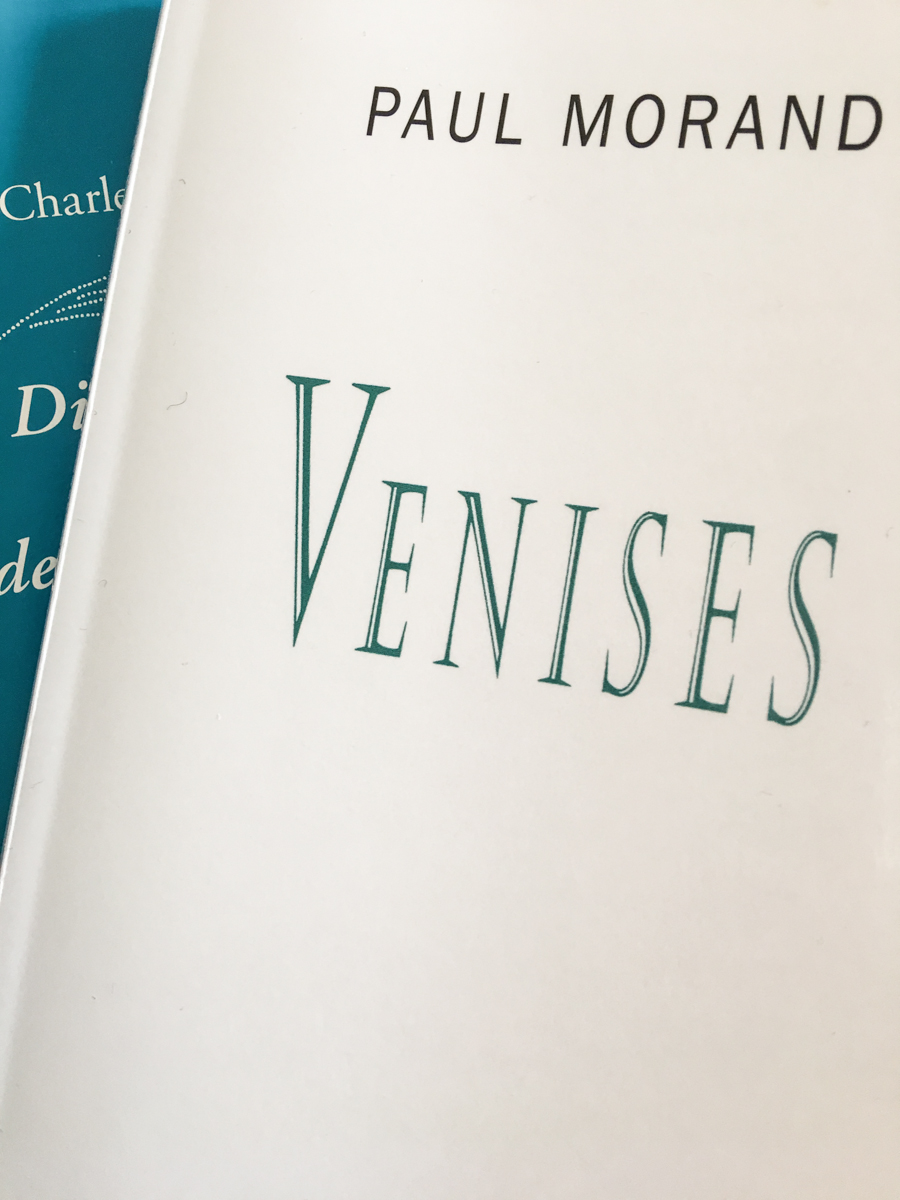
Lire Venises et mourir
Morand dit tout dès le début de Venises : « Toute existence est une lettre postée anonymement ; la mienne porte trois cachets : Paris, Londres, Venise… », puis : « (…) Venise résume dans son espace contraint ma durée sur terre… », et : (…) Je me sens décharmé de toute la planète, sauf de Venise ». A défaut d’y être enterré, Morand confiera sa vie entière à Venise.
En avançant chronologiquement, par paragraphes de longueurs aléatoires, dans ce texte publié en 1970 qui brosse 60 ans (de 1908 à 1968) de vie, Morand dresse d’abord un portrait historique de Venise (« La république des castors, dont parlait Goethe »), mêlé de plus en plus à sa propre histoire personnelle. Il ne se soucie pas de savoir si son lecteur est au courant des évènements mineurs qu’il décrit, ni des personnalités oubliées qu’il exhume du silence de l’histoire (« Edmond Jaloux, Vaudoyer, Charles du Bos, Abel Bonnard, Emile Henriot, les frères Julien et Fernand Ochsé »). Autobiographie partielle composées de tableaux, on y croise Diaghilev, Byron, Proust, Cocteau et toutes les rues que Morand a empruntées, le ramenant impitoyablement à la ville flottante, comme une série de canaux connectés.
Il faut entrer dans le rythme, la langue, les images, le ton de Morand, régler son pas sur le guide, accepter ses détours par Londres ou Paris, ses pauses, ses élucubrations, ne pas rater l’éclat d’une phrase (« Venise se noie; c’est peut-être ce qui pouvait lui arriver de plus beau. ») au creux d’un long passage descriptif et parfois ennuyeux d’une époque surannée (« en ce temps-là, le gondolier était encore roi… »). Il décrit ainsi un orgasme féminin, dans une savoureuse scène où une amante lui impose d’écouter ses ébats saphiques derrière une porte fermée : « j’eus droit à toute la gamme, jusqu’au couinement du lapin enlevé par le rapace… »
Là où Morand m’intéresse, c’est moins dans ses savoureuses miniatures saisies sur le vif des années 20 d’un intelligentsia française et européenne, que quand il raconte la modernité. C’est d’ailleurs un thème important dans son oeuvre (cf. L’Homme Pressé que je viens de recevoir en édition d’époque, ce poche aux pages jaunies, aux lettres marquées dans l’épaisseur du papier si bien qu’elles restent lisibles même si l’encre s’en va, car je ne supporte par l’impression numérique actuelle où les mots semblent seulement crayonnés sur la page, ils ne s’inscrivent plus dans la matière, ce qui est tout l’intérêt d’un livre : solidifier la pensée).
Dans la dernière partie du livre, il n’est plus question de romantisme, de guerre (souvent les deux s’entremêlent), ni d’artistes : il est question du monde moderne, d’une certaine fatigue, l’âge aidant certainement : « Je rentrai à l’hôtel, retombant sur moi-même, méditant amèrement sur le rôle des hommes d’aujourd’hui, pauvres vainqueurs domptés, en déroute devant le triomphe féminin qui éclat partout… ». Il avoue plus loin : « Je ne m’accoutumerai jamais aux façons électroniques… ».
Il trace magistralement les contours de notre nouveau monde avec l’oeil de celui qui émerge tout juste de l’ancien :
« Tout agace les dents dans ce monde où chaque heure est une heure de pointe, où les écoliers veulent être des Einsteins; les couples qui s’en vont au marché, enlacés, comme ils l’ont vu dans les films, portent sur les nerfs; leurs baisers en public, ce ne sont plus des bises, mais des repas; la chair des femmes est offerte comme de la viande. Comble d’injustice, les jeunes sont bien plus beaux que nous ne l’étions ».
« Morand est un excellent descripteur de la nouveauté. (…) Morand utilise la nouveauté pour créer des images (ce sont les mauvais écrivains qui redistribuent les cartes truquées que sont les vieilles images, les clichés) », estime fort-à-propos Charles Dantzig dans son inépuisable Dictionnaire égoïste de la littérature française. Certaines images de Morand, certains tours de main, conservent leur force en 2016… et une modernité bien plus excitante que nombre d’écrivains littératant péniblement en recyclant les déchets de la littérature.
Je laisse également à Dantzig le rappel que Blaise Cendrars, paix à son âme et à son bras, travaillait la même veine moderniste, en plus brouillon (lui qui n’a jamais eu de richesse héritée, ni de poste de fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères). Etonnamment, Dantzig omet le dernier « s » du titre Venises dans la bibliographie à la fin de son article sur Morand, alors que justement, tout est dans ce « s ». Venise n’est pas qu’une ville, c’est toutes les villes.
On trouve toute cette modernité dans la dernière partie, écrite entre 1968 et 1970 : « Venise redevenait ce qu’elle avait été au XVe siècle, une sorte de Manhattan, de cité prédatrice, excessive, hurlante de prospérité, avec un Rialto qui était le Brooklyn Bridge de l’époque, un Grand Canal, sorte de Cinquième avenue pour doges milliardaires… ». Savoureux non ? J’adore le changement de focale historique de ce passage, Morand posant soudain ses lunettes d’historien pour aller faire les courses : « … c’est le jour ou Christophe Colomb a découvert l’Amérique que la Sérénissime a préféré se laisser mourir; en doublant le cap sud-africain, Vasco de Gama lui a passé le lacet fatal; elle n’a survécu que trois siècles, ce qui est encore beaucoup quand on pense que vingt ans auront suffi pour que l’Angleterre ne soit plus qu’une ombre. A midi, j’entrai au bazar ruisselant d’oranges, de citrons crevant leurs couffins, de piments d’un rouge et jaune espagnol, de chevreaux égorgés… »
Pour terminer, j’ai particulièrement été touché par la rencontre du vieil homme avec des hippies et la façon dont il transpose leur esprit à sa propre jeunesse. La dernière phrase de cet extrait est d’une lucidité touchante et effrayante. « De quoi servirait le grand âge si l’on ne se sentait pas plus proche d’un vagabond mangeant des spaghettis de deux drachmes, sur une assiette en carton, en plein vent crétois, que de la classique famille française attablée devant un cuissot de chevreuil braisé au porto ? (…) Les amants de la grand-route, je les jalouse souvent; ils solidifient des rêves épars, ce que Balzac nomme : ‘’la vie de mohican’’, ils me rappellent notre 1920, nos insultes à la société, notre besoin de destruction, nos défis sur papier d’affiche, à l’heure où le traité de Versailles assassinait l’Europe; ils me font revivre notre ‘’feu à tout’’, ‘’feu sur tout’’. Ceux-ci, que feront-ils quand ils auront fini d’errer au bord de l’inexistence ? Je les moque, je les plains, je les envie ».
Le livre, avec Morand, finit par mourir dans ces lignes, emmenant dans la tombe un rare verbe à l’infinitif (Académie Française oblige)… et ce ne sera pas à Venise mais : « un cimetière à Trieste (…) Là, j’irai gésir, après ce long accident que fut ma vie ».