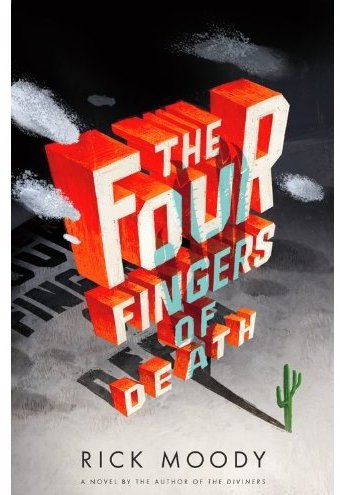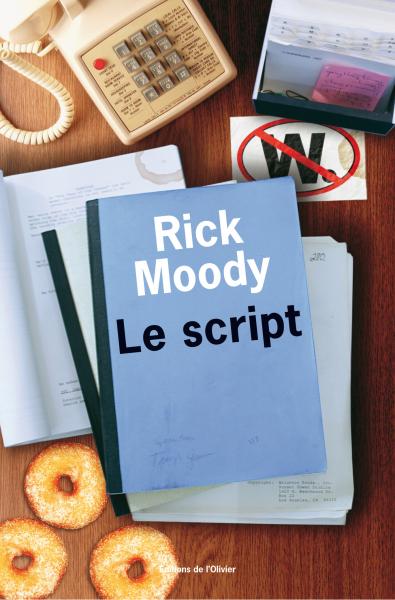
Rick Moody : le sourcier de la littérature
Je ne sais pas si Rick Moody est un grand écrivain ou pas. Je m’en fous. Ce que j’aime est qu’il est toujours dans le virage, en équilibre sur sa moto littéraire, la main sur les gaz à pousser son moteur, l’oeil fixé sur la fin de la courbe qui ne vient qu’à la dernière page. Un auteur qui ne débande pas. Un motard qui n’aime pas les lignes droites, qui déteste faire ronronner la cinquième pour regarder le paysage. Alors il emmène son lecteur cheveux au vent, sans casque, dans ses lacets de montagne plein de détours, de raccourcis, d’impasses magnifiques. Deux exemples avec Le Script et The Four Fingers of Death (non traduit).
Les digressions sont l’essence même de son histoire qui ne tient que par ses détours. C’est un rallye pétaradant et joyeux, inventif qui passe uniquement par les plus petites routes de la carte, les traits les plus étroits, parfois à peine dessinés, mais au final on a une meilleure idée du territoire que si on avait circulé sur les larges autoroutes à grande vitesse.
Il est capable de digresser 30 pages sur la quête inutile – mais tellement drôle et révélatrice du caractère obsessionnel de la femme – de gâteaux Krispy Kream. Rien n’est utile et pourtant toute cette futilité compose la structure même de ses romans.
Dans Four Fingers of Death (non traduit en français) il jette deux pages denses sur les pensées de la dernière grue cendrée survivante de son espèce dans le carnet de bord d’un astronaute en route pour mars. Ces divagations sont au cœur du réacteur nucléaire de la fiction de Moody, pas seulement de la décoration ou des apartés destinés à colorer. C’est sa narration même qui s’appuie sur ces coups d’accélérateur et de freins, sur cette myriade de scènes que notre génération fan de série télé comprend bien.
Surprenant, disais-je, et c’est finalement ce qu’on attend d’un roman : qu’il nous secoue la couenne, qu’il nous emmène là où on ne nous entend pas crier (claustrophobie…), qui propulse l’œil et l’esprit (ce qui est la même chose chez le lecteur) avec sûreté, avec une énergie renouvelable et renouvelée, d’un paragraphe à l’autre.
Chaque chapitre du Script s’intéresse à un personnage différent, parfois très éloigné de la fine intrigue principale (la vie d’un script inventé pour remplacer un autre script perdu, je ne sais plus trop s’il devient un film d’ailleurs, j’ai perdu le fil sur la fin). Une littérature de rebondissements, la balle est propulsée sans perte d’énergie, il semble même qu’elle se recharge à chaque rebond. Une explosion centripète et une force centrifuge : la poigne du romancier ramène le tout à notre portée, réorganise pour la lisibilité.
On imagine très bien ce que doivent être les brouillons de Moody : des éjaculats monstrueux… A moins que ses livres ne soient quasiment ses brouillons. Qu’importe.
C’est donc une histoire proprement impossible à résumer. L’écart entre le titre anglais et français est un signe : The Diviners (les Sourciers) et Le script. Tentative de décalquer la vie, il pétille. J’avoue me complaire dans ces sinueuses digressions d’une vieille femme obsédée par une fuite dans ses toilettes à sa fille boulimique (de beignets Krispy Kream) à un acteur de films d’action priapique à un coursier artiste atteint d’une maladie mentale à sa sœur travaillant pour la boulimique, au chauffeur de taxi indien passionné d’écriture télévisuelle qui harcèle la boulimique pour qu’elle l’embauche dans sa société de production, etc… Ça continue comme ça pendant plus de 590 pages. C’est un voyage, il faut accepter les variations de rythme, l’ennui temporaire, les plages de bruit, de fureur et le calme plat ou la fatigue du bruit ambiant. Bref, il faut accepter les trépidations irrégulières de cette traversée. Il y a de tout, œuf-jambon-fromage. Bien épicé.
Le prologue de The Diviners (Le Script en français, traduction de Michel Lederer. Editions de l’Olivier.) est un morceau de bravoure comme je les aime, c’est l’équivalent du glam rock ou des opéra rock des années 70, des envolées boursouflées, sincères et tellement excitantes dans leurs qualités comme dans leurs défauts. Ce prologue est un vol circumnavigatoire autour du globe pour observer le soleil se lever. Il décrit l’effet de la lumière sur les terres endormies, cette frontière mouvante entre la nuit et le jour qui se déplace à vitesse constante pour allumer le feu du nouveau jour. « The light that illuminates the world begins in Los Angeles »… « La lumière qui éclaire le monde naît à Los Angelez. Naît dans les ténèbres, naît dans les montagnes, naît dans les paysages déserts, dans le doute et le remords ».