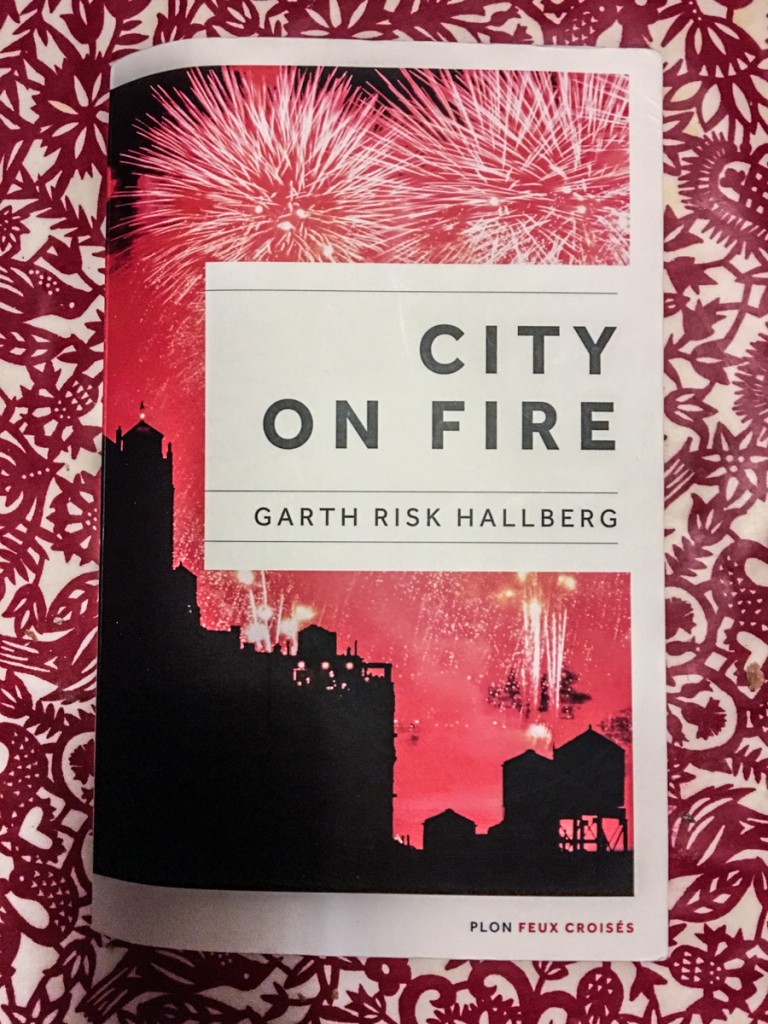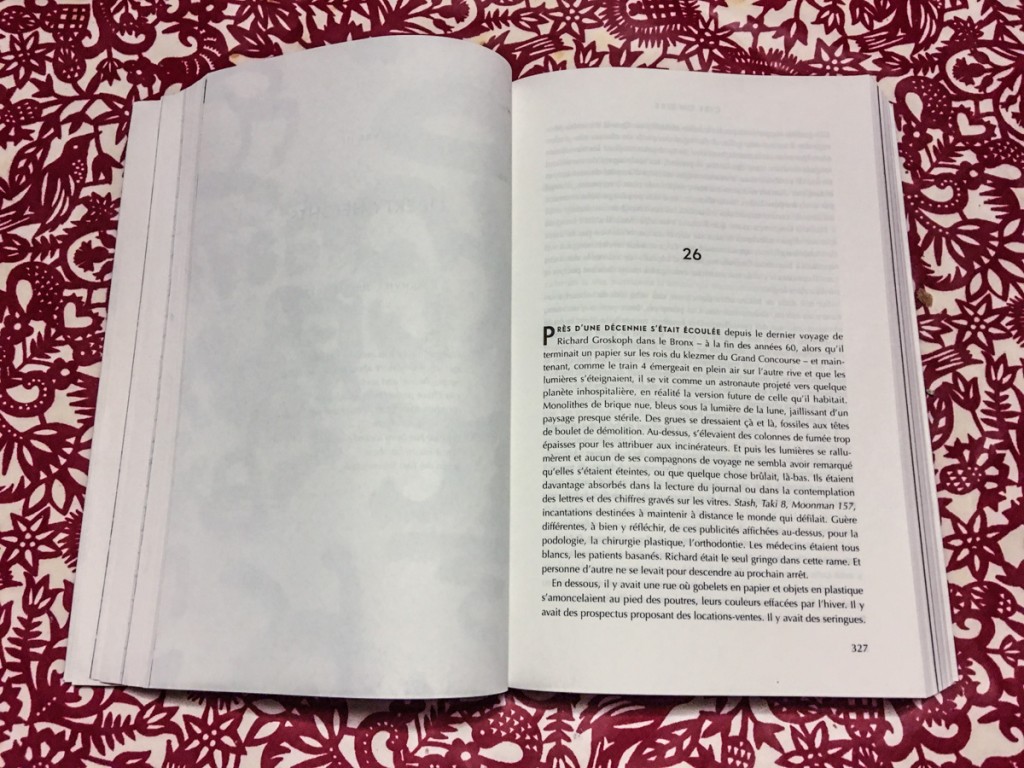
City on fire en direct liv(r)e #3
#3 La peau sur les mots
Dans cette partie, on revient en arrière, oui, c’est un flashback. Ta ta tsoin. Au début des années 60. On change de braquet dans ce second livre, comme si après la montée du premier livre, l’auteur empruntait une douce descente en roue libre pour laisser l’air secouer ses cheveux. J’ouvre le livre sur la délicieuse toile cirée de la table de la cuisine de la maison de vacances.
Les premiers mètres sont chaotiques, avec cette phrase dont la maladresse n’a d’égale que sa lourdeur. Je ne veux pas accabler la traductrice, mais franchement, un anglicisme aussi patent, ça ne se fait pas. « Keith avait toujours eu cette propension naturelle à considérer les grands moments de sa vie non pas comme des évènements qu’il provoquait mais comme des choses qui survenaient, à la manière du temps qu’il fait. Et, convaincu de n’avoir aucun prise sur eux, il suivait le mouvement ». Ouf, faut l’avaler, cette pilule. Au même moment, la campagne électorale américaine donne des nouvelles inquiétantes de ce pays, entre Clinton et Trump, les deux visages de l’Amérique, l’intellectuelle trop prudente et le businessman brutal sans morale.
On découvre les premiers pas de Keith et Regan, le premier entrant sur la pointe des pieds, impressionnés dans la riche et puissante famille de la seconde. Il fait la connaissance de William, feu follet en rupture de ban, et d’Amory, le manipulateur serviable pour le moment dont on attend le dévoilement de son véritable caractère d’ordure (car c’est la puissance de ce personnage – et de l’écrivain – de laisser deviner sans rien révéler). « Keith hocha la tête, comme un oiseau devant une pluie de graines », quand Amory lui propose du boulot… un boulot de coursier pas tout à fait honnête. La description de la dérive du couple Keith-Regan au fil des ans est fulgurante et précise, « Quand il regagnait enfin le grand appartement neuf, il trouvait son dîner sur la table enveloppé dans une feuille d’aluminium ».
Le chapitre 17 est très beau. Oui. William est encore à l’université et s’échappe le temps d’un été dans la maison du Connecticut de l’un de ses professeurs, en plein nature. Dans ce cadre virginal et quasi-mythologique, il devient un faune séduit par d’autres hommes, dans la douceur estivale, dans les reflets de l’eau de l’étang où se baignent des corps appétissants. Une éducation sentimentale tout en frôlement d’ailes de moustiques « Les moustiques se contorsionnaient, comme happés par les flammes. La glace crépitait dans son verre de Drambuie ».
William « se voyait accorder ce qu’il avait désiré dès les premiers jours après son arrivée : il n’était personne, il n’avait plus ni passé ni avenir, il n’existait plus au-delà du présent, de l’eau vive qui surgissait dans la clarté ».
De son nom complet, William Stuart Althorp Hamilton-Sweeney, notre jeune éphèbe tourne autour de son professeur, Bruno, et se demande comment il va supporter de quitter cette vallée initiatrice pour retourner à New-York. « Comment entrer à l’automne dans cette machine à reproduire les privilèges de classe sans également retourner dans sa famille dont le bâtiment de biologie portait le nom. Et puis, comme un noeud magique, le problème trouva sa solution ; il n’irait pas, tout simplement. Et une fois sa décision prise, son avenir lui sembla assuré. Rendre tout possible : c’était l’une des formules qui enchantaient cette vallée ». Il entre finalement dans l’université d’une petite ville, « ce fut l’année où l’on conduisait défoncé sans jamais se crasher. Où on entrait dans des classes en pleine nuit pour couvrir les tableaux d’écriture automatique et en ressortir sans avoir allumé la lumière ». Quelle meilleure description de l’adolescence ? Il revient finalement à New York, assumant dorénavant son homosexualité, « et cette fois, (New-York) allait le protéger, il en était sûr. Jamais plus ils ne se laisseraient tomber ».
Il a un sacré savoir-faire de storyteller ce Garth, il sait doser la longueur de ses paragraphes, donner suffisamment de détails, poser la bonne métonymie au bon endroit, c’est presque scientifique la façon dont il relance l’attention, termine ses paragraphes avant qu’ils ne trainent en longueur (à l’exception de la scène d’interrogatoire par le commissaire, cf #2 que je trouve un peu longue), il revitalise, nous emmène à droite et à gauche, d’une époque à l’autre, avec facilité. Cette aisance cache probablement beaucoup de travail mais le lecteur ne le sent pas. Il a cet incroyable fluidité d’un John Irving… avec la densité. C’est très « Grand Roman Américain » (cf le premier volet de #livreenli(r)e) en fait.
Dans le chapitre suivant, on rencontre Richard Groskoph (une déformation de l’Allemand voulant Grosse Tête ?), un journaliste ami du commissaire Pulaski (à retenir pour la suite). L’auteur nous trimballe d’une époque à l’autre, du passé au futur, avec une fluidité maitrisée. C’est un savoir-faire remarquable de ne pas perdre le lecteur dans les allers-retours temporels. Un autre le réussi magistralement, avec une caméra.
« Il voulait que ses articles soient, non pas infinis exactement, mais assez vastes pour suggérer l’infini ». Le journaliste, « Lâche. Raté. Ivrogne », s’envole en exil, loin d’un enfant non désiré avec une hôtesse de l’air, car « s’il continuait comme ça, il finirait hospitalisé à Bellevue avant la fin de l’été ». Après un exil sur une île écossaise, le journaliste revient à New York et s’intéresse à un spécialiste des feux d’artifices, Carmine Cicciaro, le père de Sam, l’occasion pour Richard de redevenir ce qu’il était, « un appareil-photo attaché à un magnétophone. Quelqu’un qui se résorbait dans tout ce qui n’était pas lui. Un récepteur, un connecteur, une machine conçue exactement pour ça ». D’ailleurs, l’interlude qui clôt cette partie est composé de l’article qu’à écrit Richard sur l’artificier et se termine par la référence à Sam, « la fille de Carmine gisait dans Central Park, un ou deux agresseurs inconnus lui ayant logé deux balles (ben oui, c’est deux, ndla) dans la tête, et que son sang colorait la neige en rose ».
Puis Charlie, juif et d’une famille modeste, devient catholique et découvre la musique, un monde où « Elton John engendra Queen et Queen engendra Frampton ». Il traverse l’adolescence d’une façon totalement différente de William, « il mettait la musique à fond, il se déshabillait entièrement et se regardait nu dans la glace accrochée à son mur au milieu des posters et des pochettes d’albums qu’il avait punaisés dans le placage en bois fin comme du papier à cigarette. Mickey (son pote, ndla) avait beau déclarer qu’il ne le faisait jamais, que chaque infraction entrainait sept ans de purgatoire, Charlie ne pouvait s’empêcher de se toucher ». Une phrase décrit bien ce rétrécissement du monde qu’on ressent adolescent à l’école :
« les dernières heures de cours commencèrent à être interminables, comme un télescope tourné dans le mauvais sens ».
Puis son père meurt et son pote Mickey le lâche, le roue de coup « méthodiquement – d’un air presque désolé » à cause d’une mauvaise blague de Charlie, qui ne faisait que chercher l’amitié enfuie. Et c’est là que Charlie rencontre Sam… Les mots commencent à fabriquer de la peau autour des personnages, de l’épaisseur, une existence plus réelle. Sur une telle longueur, le coureur de fond qu’est le lecteur commence à n’avoir plus que la peau sur les os (lire épuise et revigore à la fois) alors que les personnages, eux, s’étoffent et prenne les mots sur les os.
Mercer, l’amant de William, d’où vient-il ? C’est le sujet du chapitre suivant. « Sa principale faiblesse en tant que romancier s’expliquait par son incapacité à se confronter à la complexité de la vie réelle ». On suit son arrivée à New York comme jeune professeur, ses galères de colocation et sa rencontre avec William, par hasard, dans la rue, puis lors d’un concert clandestin dans Central park. « Il limitait son amitié avec William à l’ouest de Broadway et au sud de Houston Street, sûr qu’aucun collègue ne l’y surprendrait », avant d’emménager progressivement ensemble.
Contrastant avec le modeste écrivaillon, l’héritier-rebelle William, lui, est attiré par les drogues, les hommes anonymes de Penn Station et la musique rock.
« C’est à peine q’il parvint à replacer l’aiguille au début de la plage et puis, au bout d’un moment, ce fut inutile. La musique était à l’intérieur. Il s’était insinué dans le haut-parleur ».
Comme le fond d’un lac que l’exceptionnelle clarté de l’eau parfois révèle, les liens secrets et dissimulés par l’auteur apparaissent à mesure de la lecture. Il ne faut pas trainer entre les chapitres au risque d’oublier des détail importants. Je tiens le rythme, j’ai disposé du premier tiers du livre et le printemps arrive, les jours s’allongent, la chaleur est plus franche, plus sûre d’elle. Le livre fait partie de mon quotidien maintenant, j’ai du plaisir à retrouver les personnages et m’inquiète pour leur sort, ce qui est précisément ce qu’on demande à un roman, non ?